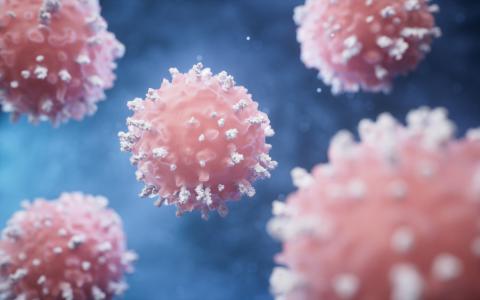
MALADIES INFECTIEUSES ET IMMUNITÉ
Poursuivre l’étude sur les maladies infectieuses afin de développer de nouveaux vaccins et de nouveaux immunomodulateurs, en particulier dans les infections chroniques et les maladies inflammatoires associées.
La recherche vaccinale contre les pathogènes respiratoires, mais aussi contre de nouvelles cibles comme les bactéries multirésistantes et les poxvirus, sera encouragée, sans exclure l’expérience acquise sur l’infection SIV/HIV
Outre la compréhension des mécanismes génétiques favorisant la dissémination de la résistance, l’un des besoins les plus urgents dans le domaine des maladies infectieuses est le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques et de tests diagnostiques rapides.
DESCRIPTION ET PERIMETRE
L’inflammation constitue le dénominateur commun rassemblant les efforts de toutes les équipes. L’implication majeure de l’unité pendant la crise du COVID illustre sa capacité de réactivité face aux nouvelles menaces.
- Comprendre et contrôler les maladies infectieuses et le mécanisme génétique qui favorise la propagation afin d’orienter les stratégies préventives, thérapeutiques et vaccinales.
- Faire progresser le développement de vaccins. en étudiant l’induction de la mémoire immunitaire innée, l’effet de la persistance des antigènes vaccinaux, et en explorant des approches personnalisées de la vaccination.
- Comprendre les mécanismes de contrôle naturel du VIH en vue d’une stratégie de guérison, clarifier le rôle du tissu adipeux dans la persistance des pathogènes infectieux et caractériser les mécanismes immunomodulateurs favorisant la persistance des pathogènes.
- identifier de nouveaux mécanismes de résistance, les éléments génétiques responsables de leur propagation et l’épidémiologie des traits de résistance majeurs
- Développer des tests diagnostiques rapides innovants
IMPACTS ATTENDUS
L’épidémie de COVID a montré les faiblesses des systèmes de santé dans le monde. De nouvelles menaces liées à de nouveaux agents pathogènes apparaîtront. Ainsi plusieurs agents pathogènes respiratoires constituent une menace directe pour l'homme : la grippe avec ses différentes souches présente un risque élevé de pandémie en cas de transmission inter-espèces importante, son étude est une priorité. D’autres infections virales ont un impact sanitaire majeur, notamment chez les nourrissons, avec une connaissance limitée de leur physiopathologie et de faibles ressources thérapeutiques.
Par ailleurs la résistance aux antibiotiques compromet l’efficacité des traitements et augmente la mortalité due aux infections. Selon l’OMS, elle pourrait devenir l’une des principales causes de décès d’ici 2050. D’ores et déjà, l’augmentation des infections résistantes entraîne une hausse des hospitalisations, des coûts de traitement et des complications médicales.
Parmi les contributions majeures de l’unité de recherche en tant qu’opérateur d’IDMIT (Infectious Disease Models for Innovative Therapies), deux réalisations notables ayant un fort impact sanitaire et économique sont à souligner : le développement préclinique du vaccin VAL1553 contre le Chikungunya, produit par VALNEVA, ainsi que celui du vaccin Dengvaxia de Sanofi Pasteur, désormais commercialisé.
Ces développements techniques serviront également à poursuivre les recherches sur un pathogène particulièrement meurtrier dans les pays du Sud : la tuberculose. Grâce à des collaborations internationales, seront également étudiés les possibles candidats vaccins contre M-POX, avec comme objectif la réactivité croisée avec la variole.
Enfin, les données fournies par l’équipe de recherche AMR (Antimicrobial Resistance) permettent d’alerter les autorités de santé publique et la communauté médicale sur l’émergence de nouveaux mécanismes de résistance, d’évaluer les risques de propagation et de déterminer les meilleurs outils de diagnostic.
LES PRINCIPAUX PORTEURS DE PROJETS
Pr Olivier Lambotte est médecin, responsable de l’unité médecine interne et immunologie clinique à l'hôpital Bicêtre AP-HP. Il occupe le poste de vice-doyen chargé de la pédagogie à la Faculté de médecine Paris-Saclay et directeur de la Graduate School Life, Sciences and Health de l’Université Paris-Saclay. Ses travaux de recherche se concentrent sur l'immunologie clinique, avec une attention particulière portée aux mécanismes de persistance du VIH, au sein du laboratoire Immunologie des maladies virales, auto-immunes, hématologiques et bactériennes (Université Paris-Saclay, CEA, Inserm).
Christine Bourgeois est chercheuse spécialisée en immunologie. Après avoir développé un programme sur les mécanismes immunomodulateurs régulant les réponses des cellules Tdans le contexte de l'infection par le VIH, elle rejoint l'équipe du professeur Olivier Lambotte au sein du laboratoire Immunologie des maladies virales, auto-immunes, hématologiques et bactériennes (Université Paris-Saclay, CEA, Inserm) pour développer un projet sur l'immunité spécifique aux tissus, notamment dans les infections virales comme le VIH et le SARS-CoV-2. Ses recherches visent à comprendre l’influence des traitements sur l’immunité des tissus.
Dr Elisabeth Menu, docteure en immunologie, a mené des recherches sur l’activation des cellules T et la transmission du VIH-1. Après un postdoctorat à Harvard, elle intégrel’INSERM en 1998, puis dirige une équipe de recherche à l’Institut Pasteur de 2000 à 2015. Depuis 2016, elle travaille au laboratoire Immunologie des maladies virales, auto-immunes, hématologiques et bactériennes (Université Paris-Saclay, CEA, Inserm) sur l’immunité des muqueuses et les infections respiratoires. Ses recherches portent sur l’environnement mucosal, l’immunité innée et le rôle du microbiote. Elle a cofondé le réseau européen FEMIN de scientifiques et de cliniciens ayant un intérêt commun pour l'immunologie muqueuse et les infections sexuellement transmissibles (IST) et y occupe plusieurs postes de responsabilité scientifique.
LES EQUIPES
Ces projets liés aux maladies infectieuses impliquent directement 3 équipes de recherchedu laboratoire Immunologie des maladies virales, auto-immunes, hématologiques et bactériennes (Université Paris-Saclay, CEA, Inserm) soit environ 60 personnes.
Ces équipes travaillent également en étroite collaboration avec les membres du FHU Care2 et de l’IHU Prometheus.
Enfin, les équipes s’appuient sur différentes ressources au sein de l’Université Paris-Saclay et bénéficient de l’expertise technique et d’ingénierie de scientifiques du CEA et Inserm dans les domaines de la cytométrie, l’imagerie in vivo, l’Immune-monitoring, la pharmacologie, les sciences animales et l’Informatique et bioinformatique.
En parallèle, le volet One Health du programme sur la résistance aux antibiotiques est développé en collaboration avec d’autres universités à l’international et notamment avec l’Université d’Exeter, sur les aspects recherche et enseignement.
